Article d’Olivier Abel paru dans La Croix du 20/11/23 au sujet du Livre de l’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault, de la juriste Christine Lazerges et du théologien Joël Molinario, sur les Violences systémiques dans l’Église
La lecture du livre de l’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault, de la juriste Christine Lazerges et du théologien Joël Molinario, sur les Violences systémiques dans l’Église (1), donne à penser. L’importance de ce livre tient à ce qu’il part des mots mêmes des victimes. La justice en est déplacée vers sa fonction restauratrice qui est d’abord d’entendre, de faire entendre la plainte – et c’est la force de l’écoute qui fait, pour reprendre l’expression magnifique d’une plaignante, « passer du statut de victime à celui de témoin ».
Véronique Margron, dans sa belle postface, concentre la question autour du verrou du sacrement de pénitence. Et elle ajoute : « verrou qui situe le dire sur la sexualité uniquement dans le lieu du mal, du mal faire, du mal penser et qui par là même en fait un lieu mauvais, impur… »
C’est peut-être là le point principal de la Réforme que nous avons tous oublié. Nous avons reçu de l’apôtre Paul un idéal sexuel de chasteté : l’instinct sexuel est irrépressible, il faut donc le réguler par le mariage et la procréation.
Cette morale plus stoïcienne que biblique a globalement triomphé, et nous avons oublié la protestation des temps de la Renaissance évangélique et des Réformes, qui redécouvre en lisant la Genèse qu’il n’est pas bon pour l’humain d’être seul, et que la vie en couple est bonne et voulue par Dieu.
On pourrait s’attendre à ce que le penseur protestant que je suis rappelle comment Luther s’était déjà attaqué à la réduction de la pénitence publique et liturgique à une pénitence individuelle, sous le secret absolu de la confession. Et que l’une des causes de la Réforme au XVIe siècle n’était autre que de substituer une conception plus horizontale et synodale de l’organisation de l’Église. Mais je voudrais dire que ces questions nous concernent tous, je dirais toutes religions confondues, et au-delà, car ce sont là des logiques institutionnelles très lourdes.
Ce n’est pas seulement la question d’une gouvernance autoritaire, autour de la sacralisation des prêtres, vus comme les représentants de Dieu. Cette forme verticale de représentance est peut-être aussi au fond de notre conception du politique, et il n’est pas si facile de s’en défaire, même lorsqu’elle se sécularise et se déguise (voyez les gourous du développement personnel !). Cette ecclésiologie verticale se manifeste dans une sorte de solitude du pouvoir. Et surtout par un monopole exorbitant, qui est le monopole du pardon.
Dans l’ouvrage, nous tournons sans cesse autour du thème de la perversion du sacrement de pénitence, et d’un abus du pardon, à la fois accordé par le prêtre à lui-même et exigé de la victime. Nous sommes bien là au nœud à la fois anthropologique, juridique et théologique de toutes nos questions. Le fond du problème n’est pas seulement l’injonction au pardon exigé par l’institution, ni que le pardon serait l’instrument d’une culture du silence, de la soumission.
C’est que l’Église romaine se soit construite sur le monopole du pardon, c’est-à-dire sur une formulation théologique où le pardon, acte régalien par excellence, et qui viendrait de Dieu seul, serait en quelque sorte délégué au souverain pontife, et par la voie apostolique au prêtre. C’est ce monopole qui a permis jadis à des religieux de protéger des chefs de milice nazie à qui ils avaient pardonné, court-circuitant l’institution de la justice. C’est ce monopole qui permettait encore naguère de gérer entre soi les abus sexuels.
Si nous voulons penser un christianisme qui tenterait de « se réinventer à partir de la source évangélique de son message », il faut, comme le propose Joël Molinario, revenir à l’Évangile, par exemple celui de Matthieu au chapitre 18 (« Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel »).
Mais il faut le lire à la manière très originale qui est celle de Hannah Arendt, quand elle estime que la grande invention de Jésus, qu’elle qualifie de proprement politique, est d’avoir annoncé que, loin que le pardon soit le monopole du prêtre ou du roi, tous les humains ont le fragile pouvoir de pardonner, et d’ailleurs aussi de promettre – Dieu pardonne « comme nous pardonnons ». C’est d’ailleurs le message permanent de Jésus : « Vous pouvez ».
L’institution de la justice passe par celle du tiers, qui interdit de se venger soi-même. Mais en dernière instance, le pardon ne saurait être délégué : il n’est pas possible de pardonner à la place des victimes, ni de demander pardon à la place des coupables.
C’est là en effet la pierre d’angle d’une conception toute différente de l’institution, qui repose en dernière instance sur la capacité de repentance et de pardon de chacun, que nul ne peut faire à sa place. Cela a peut-être beaucoup à voir avec la synodalité, sinon la démocratie, qui sont aujourd’hui profondément à réinventer.
Olivier Abel
La Croix, 20/11/2023
(1) Violences systémiques dans l’Église catholique. Apprendre des victimes, Dalloz 2023.

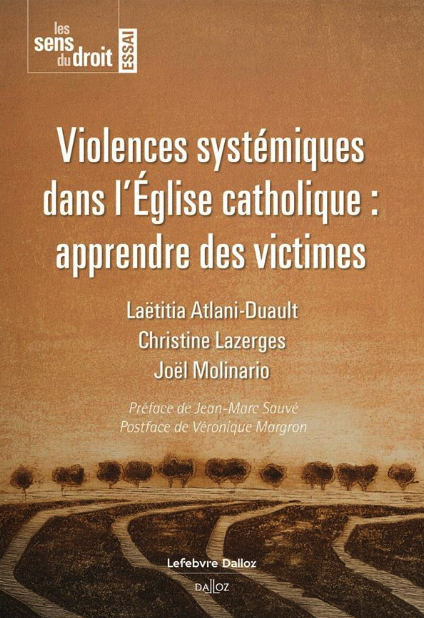






Laisser un commentaire