Benjamin Stora
UNE MÉMOIRE ALGÉRIENNE
Robert Laffont (Bouquins), 2020, 1039 p., 32 €
Le président Macron vient de confier à Benjamin Stora la mission de trouver un terrain d’entente avec l’Algérie pour rapprocher les mémoires antagonistes de la colonisation et de la Guerre. Son partenaire algérien est le Docteur Abdelmadjid Ckikhi, directeur général du Centre national des archives algériennes. Cette mission intervient au moment même où paraît dans la collection Bouquins la réunion de six ouvrages de Benjamin Stora concernant l’histoire récente de l’Algérie.
Le premier récit (p. 3-100) nommé « Les clefs retrouvées » mêle récit personnel et travail historique. Tout comme le livre du rabbin Sirat, il aurait pu s’intituler « Itinéraire d’un enfant juif d’Algérie ». Sirat est né à Bône en 1930, Stora à Constantine en 1950. Tous deux racontent une enfance dans le quartier indigène, séparé de la ville européenne, où juifs et musulmans « vivaient imbriqués les uns dans les autres » et où tous parlaient arabe. La différence est que les juifs sont citoyens français depuis le décret Crémieux de 1870, sauf la parenthèse de Vichy (1940-1943). L’attachement à la France est le même dans les deux familles. Les deux pères ont fait une guerre, celle de 14-18 pour Sirat, celle de 39-45 pour Stora. L’Algérie française est pour eux une évidence.
Les différences vont intervenir avec l’arrivée en France qui ne se fait pas dans les mêmes conditions. Sirat y vient pour ses études. Stora, à cause des violences de la guerre civile, les bombes, les atrocités de part et d’autre. Le départ de 1962 pour sa famille est un exil, un déclassement et un déracinement à tout point de vue, même religieux, puisque dans la France d’alors le judaïsme est majoritairement ashkénaze, différent de la pratique séfarade, ce qui avait aussi frappé Sirat deux décennies plus tôt. Plus tard, en 2006, Stora publiera une histoire des juifs d’Algérie sous le titre « Les trois exils des juifs d’Algérie » (pages 445-596). Mais les ressemblances s’arrêtent là car Sirat va devenir rabbin alors que Stora va s’émanciper de la religion. C’est ce qu’il raconte dans le deuxième récit de ce « Bouquin » (pages 105-326) : « La dernière génération d’octobre ». Benjamin Stora participe joyeusement à mai 68 et le ressent comme une intégration dans la société française. « J’étais brutalement propulsé dans un nouveau monde, celui du matérialisme, de la société divisée en classes et non en communautés. J’éprouvais comme un soulagement, une libération, un affranchissement de la soumission organisée par des rites religieux … La précipitation dans l’histoire révolutionnaire m’a libéré de la peur religieuse et a aiguisé ma curiosité. » Cette curiosité va l’orienter vers des études à la fois d’histoire et de sociologie. Son activisme « révolutionnaire » dans un mouvement trotskyste est tel que l’on se demande comment il a fait pour réussir aussi brillamment ses études, thèse d’histoire, puis thèse de sociologie, avant le doctorat d’Etat soutenu en 1991, tout en publiant en même temps plusieurs livres. Nommé maître de conférences en 1982, il quitte l’OCI (Organisation communiste internationaliste) en 1986 pour se consacrer à la recherche. Dans l’ouvrage « Les guerres sans fin. Un historien, la France et l’Algérie » (pages 327-440) il retrace sa biographie intellectuelle et universitaire. Il a choisi de travailler sur l’Algérie car ce sujet d’étude était négligé à cette époque. Il ne se doutait pas encore que derrière la « Grande Histoire » il retrouverait « la petite, les déchirements personnels, les blessures intimes. »
Il lui a été reproché de mêler au travail historique le plus rigoureux, fondé sur des documents, ses souvenirs personnels vécus, de jouer à la fois sur la proximité et la distance critique. Mais c’est cet enracinement dans l’histoire qui lui permet de comprendre ce qui est une des spécificités de ses livres, la différence entre la mémoire et l’histoire. La mémoire est subjective. Pour l’Algérie, côté français, il décompte quatre mémoires : celle des pieds noirs, celle des harkis, celle des soldats du contingent, celle des immigrés. Quatre mémoires cloisonnées, chaque groupe considérant avoir sa vérité. « Un ghetto mémoriel ». En Algérie, le gouvernement a sa propre vision arrangée de l’Histoire, celle qui lui permet d’asseoir sa légitimité. La mémoire de « la guerre de libération », le rôle unique dévolu au FLN, à l’armée, ont volontairement effacé les autres mémoires.
Dans la recherche pour laquelle il lui a été demandée de rapprocher les mémoires, il explique que seul un véritable travail historique mené de bonne foi, objectivement, et ensuite largement diffusé par des films, des émissions TV, et grâce à la formation des professeurs, peut permettre de dépasser ces antagonismes. L’enjeu, dit-il, est « une République partagée par tous. »
Un compte rendu de Gabrielle Cadier-Rey, pour LibreSens

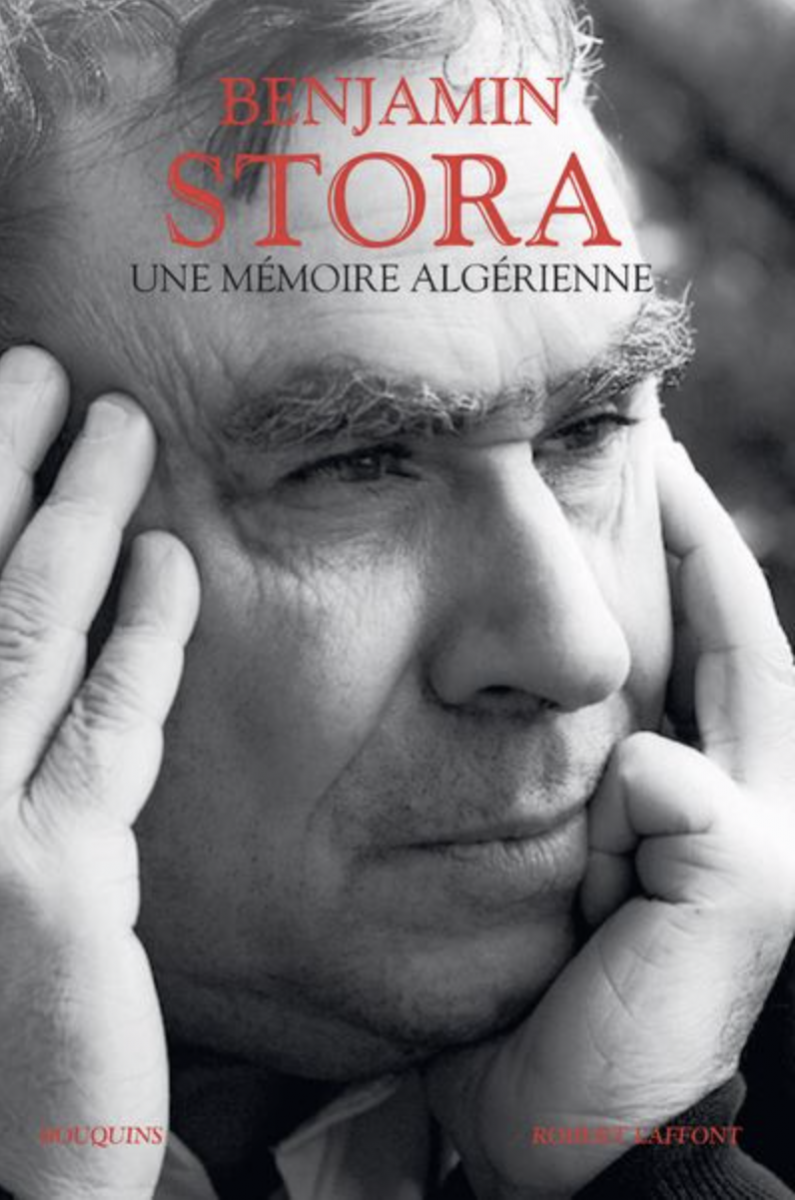






Leave a Comment