Pour toute la période de la guerre nous étions à Alger, au début on l’a ressentie par le blocus et par les restrictions, alimentaires et de tous les produits manufacturés venant de métropole. Après le débarquement allié du 8 novembre 1942, elle fut plus présente avec les alertes pendant lesquelles, après une première tentative de descente dans les abris, nous avons préféré rester à la fenêtre (pas trop près quand même à cause des éclats d’obus) : c’était un impressionnant feu d’artifices de la DCA (Défense Contre Avions), qui a laissé peu de chances aux avions allemands d’arriver au-dessus de la ville pour lâcher leurs bombes (il y a eu pourtant des victimes). Les lendemains d’alertes, j’allais ramasser les éclats d’obus dans les rues, j’en avais une petite caisse. Un jour sur la terrasse rouge en bas du jardin, j’ai vu un petit obus non éclaté planté dans le carrelage. Je l’ai un peu touché, avant de me dire que cela pouvait être dangereux, et de le signaler à mes parents qui ont fait venir les démineurs. En fait, j’ai trois copains (dont deux fils du pasteur Caron collègue de Papa, mort lui-même dans un accident d’avion 18 mois auparavant), qui sont morts en faisant exactement le même geste que moi…
Le monde nous paraissait simple : le Mal c’était l’Allemagne nazie, le Bien nos alliés, et le paradis hors de ces conflits : la Suisse. Je me rappelle une remarque entendue qui m’avait étonné : « Dès la fin de la guerre il va y avoir du tirage entre Russes et Américains ». Comment imaginer que les alliés d’aujourd’hui deviennent ennemis demain ? Ma vision politique du monde a commencé là à se compliquer. Daniel Pennac a complété mon éducation : « L’histoire, c’est ce qui met la pagaille dans les cartes de géographie ».
Il fallait faire attention à la censure quand nous écrivions en France occupée. La famille avait un code pour cela : Les Anglais étaient “Jeanne” (ma tante Jeanne était anglaise), les Américains étaient les cousines de Jeanne, les Allemands “Éléonore” etc. Ça donnait, juste après le débarquement allié, ce genre de textes : “Vous devinez avec quelle émotion et quelle joie nous avons reçu Jeanne et sa cousine ; dans l’ensemble la famille les a accueillies d’une manière touchante, et elles sont assez discrètes pour qu’on continue, je l’espère, à bien s’entendre. Les enfants ne les quittent pas, et mendient impudemment des bonbons et du chocolat ! Elles nous ont fait faire la connaissance de leur amie Décéa, qui est tout à fait remarquable et bien jolie ; nous l’avons revue ce soir après dix jours où nous n’avions pas eu l’occasion de la rencontrer…”
Comme nous n’avions plus classe que par demi-journées, nous traînions beaucoup autour des soldats, à qui nous mendiions souvent bonbons et chocolats et qui nous apportèrent nos premiers rudiments d’anglais. Ils nous firent aussi découvrir le chewing gum, à la grande horreur de Maman. J’avais vu des copains le manipuler avec aisance, en faire éclater des bulles, l’allonger en longs spaghettis : en essayant d’en faire autant la première fois je m’en suis collé sur tout le visage et Maman a passé un quart d’heure à essayer de m’en libérer… avec des techniques qu’elle ne maîtrisait pas mieux que moi.
Papa créera un “foyer du soldat”, 14 rue Michelet, nous irons parfois y prêter un peu de notre jeunesse à ces hommes loin de leurs foyers. Pour pallier les insuffisances des autorités, il créera aussi un “lycée” dans les locaux paroissiaux du rez de chaussée de notre maison. Il en était très fier ! Il organisait des camps d’été, auxquels nous participions si nous n’étions pas ailleurs, (en camp de louveteaux en Kabylie (Yakouren, Tiffrit) par exemple). C’était à Douaouda, à une trentaine de kilomètres à l’ouest d’Alger, où la famille Jourdan (la ferme des Autruches) avait mis un très grand espace à la disposition du camp (sous tentes) entre pinède et mer ; une colline était le lieu de tous les moments sérieux et inspirés, en particulier au coucher du soleil. Il y a eu un été jusqu’à 600 participants. Après tant d’années, nous faisons encore des rencontres de gens qui y ont participé et s’en souviennent avec émotion.
Les difficultés de ravitaillement ont été permanentes. Nous avions chacun notre ration de pain (parfois du pain de maïs auquel nous trouvions un goût de vomi) à gérer pour la journée. Papa avait trouvé une fois je ne sais où un sac de 50 kg de raisins secs, il était dans la cuisine et nous pouvions y puiser à volonté. Une autre fois c’était un sac de farine de noyaux de dattes. Les charançons se multipliaient à toute vitesse dans les céréales. Dans le tiroir du buffet de la cuisine, les souris rongeaient nos cartes de rationnement pour faire leur nid ! Après le débarquement allié du 8 novembre 42, il arrivait que la famille pastorale reçoive une caisse de conserves, échouées de bateaux alliés coulés au large. Il n’y avait plus d’étiquettes, et on ne savait jamais si en ouvrant une boîte on tomberait sur du pâté, trois pommes de terre à l’eau ou des tranches d’ananas…
Le 8 mai 1945, nous nous sommes retrouvés avec toute la foule devant la Grande Poste, chantant et dansant des danses folkloriques pour fêter la capitulation de l’Allemagne nazie. Depuis le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, il y avait sur le fronton de la Grande Poste une immense carte de France, sur laquelle chaque jour était peinte en blanc la portion de territoire libéré. J’ai repris l’idée en couvrant de blanc sur une carte du monde les régions où j’ai posé le pied, ça n’en fait pas beaucoup ! Hélas je m’en irai avant d’avoir tout visité. En revanche j’apprécie beaucoup que les déménagements de nos enfants nous fassent connaître comme de l’intérieur, quand nous allons les voir, des quartiers de villes ou des coins de campagne nouveaux…
André Leenhardt

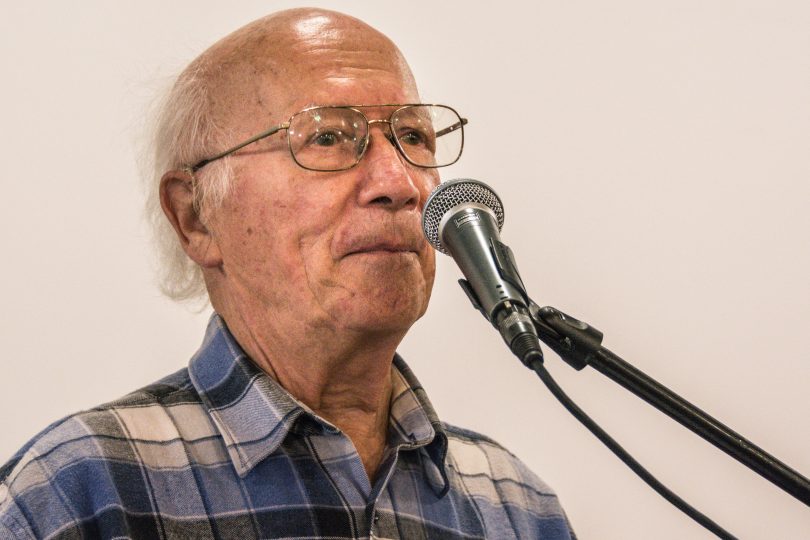






Leave a Comment